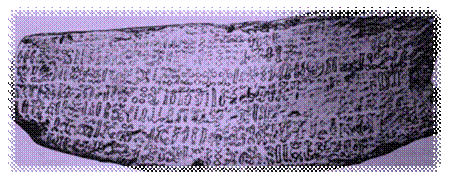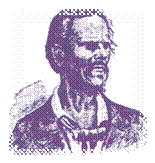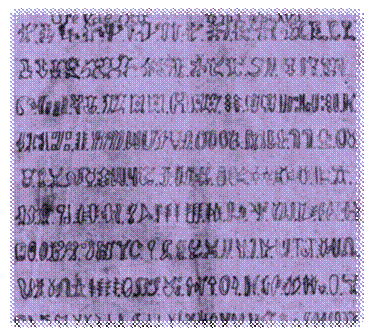|
Linguistes
et lecture du rongorongo Par Lorena Bettocchi
Chapitre
II Sémantique,
cosmogonie, chant de la pluie Rapanui
1886 : Les Maori Ure-Vae-Iko et Kaitae récitent devant le Commodore Thomson Quatre
années de travail me furent nécessaires pour explorer les chants
de l’ancien Ure Vae Iko (né en 1803), d’après les notes prises par Thomson,
mandaté par la Smithsonian Institution de Washington en 1886. Les chants d’Ure Vae Iko furent
des "rongo" : chants de la
tradition orale, clamés par l’Ancien, un peu forcé par des étrangers
qui lui présentaient les photos de tablettes ou les deux antiquités achetés
par Thomson à cette occasion (la petite et la grande de Washington).
La petite
de Washington appelée Atua mata riri -
Doc Thomson, photographie d’un moulage courtoisie
Smithonian Instutution de Washington, Retranscrits
en langage phonétique incertain -parfois abrégé, certainement dactylographié
et typographié avec des erreurs- ces
chants contiennent des indications sur les "rongo" de la tradition
orale, mais non sur le grand rongorongo ancien, la grande étude du peuple Rapanui. J’avais calculé
que les notes de Salmon qui les
consigna à Thomson contenaient environ
70 % de mots anciens rapanui. Ces récitations étaient donc, à mon sens, matière à étude et construction
d’une base de données. En
2002, j’ai participé à un atelier collectif
lancé par le CEIPP[1]
de Paris qui mit en place une
commission dite "Apai" sur un seul chant de Ure Vae Iko : nous
savions que l’Ancien psalmodia cette longue récitation devant la photo de la
tablette Keiti. J’ai travaillé, pour
ma part sur tous les textes de Ure Vae
Iko avant de faire connaître mes conclusions[2]. J’ai
fait une découverte d’importance au sujet du chant Atua Mata Riri, le dernier chant que j’ai
étudié : cette découverte fut
publiée sur le web en septembre 2004, elle remit en question les conclusions de
Stephen Fisher (une page sera consacrée à ce linguiste nord-américain). Auparavant,
au CEIPP, un certain nombre de graphiques furent extraits du chant Apai d’Ure
Vae Iko -à partir du texte brut de Thomson et non à partir du texte que
j’avais orthographiquement restructuré mais en fait que personne ne voulait
considérer par manque de confiance sans doute. Ces graphiques étaient
destinés à vérifier les statistiques
d'autres linguistes comme par exemple les statistiques de Konstantin
Podzniakov. Il fut produit
par Raymond Duranton des statistiques utiles sur les voyelles, les
consonnes et les syllabes, statistiques
auxquelles je n’ai pas participé.
Mon travail, sur les chants de Ure Vae Iko n’existait qu’en
sémantique, dans la recherche des mots d’autrefois qui nous manquent tant
pour travailler le rongorongo.
Sous mon copyright, ces chants, ainsi que la langue "ancienne" de
Ure Vae Iko -un glossaire d’étude selon l’arero rapa
nui, l’éo enata et l’arero rarotonga- apparaissent sous le
chapitre Rongo de Ure Vae Iko, dans ce
même site, ainsi que les tableaux qui concerne chacun de ses chants. Atua
mata riri ou la pierre de Rosette :
de mémoire, l’Ancien Ure Vae Iko psalmodia un chant de la création en commençant par implorer le pardon de Dieu, car il
était catholique : Atua mata riri ! Dieu me voit réciter
les tablettes tabou qui mettent mon âme en danter et
va se mettre en colère dit-il.
Mais aidé par un stimulant, car on le fit boire, il continua. Un quart des vers de la poésie fut consacré, en effet, à la connaissance
des Ariki, à la cosmogonie. Puis de mémoire toujours, se souvenant des chants durant les
cérémonies annuelles du roi Nga-ara, l’Ancien commença à décrire les signes de la petite tablette que Thomson venait
d’acheter. J’ai mis longtemps avant de comprendre qu’Ure Vae Iko décrivit
plusieurs sections de la tablette : ce que les Pascuans, eux, savaient depuis fort longtemps. Allez voir
comment Ure Vae Iko né en 1803… se mit à décrire les signes. http://www.rongo-rongo.com/atua-mata-riri.html
Nous
sommes donc devant une banque
de données rapanui datant d’avant 1886. Ure Vae Iko fut traité de
mystificateur car on échangea les photos des tablettes, alors qu’il
récitait. Mais il ne lisait pas et ne prétendit pas le faire : « nous connaissons le contenu mais
les paroles anciennes se sont perdues » dit–il. Sur trois tablettes, il expliquait l’usage
que l’on faisait autrefois de cette écriture. Tabou, sacrée, ki ariki, répétait-il dans ses récitations : connaissance
des ariki, art royal. Baptisé
avant la mort du frère Eugène Heyraud, on lui avait dit que les tablettes
profanes mettaient son âme en danger. Comme on lui présenta des photos faites
par Thomson lors du passage à Tahiti
chez Mgr Tepano Jaussen, il reconnut des tablettes anciennes données
aux missionnaires et le fait que le bon Evêque considérât l’écriture comme un
grand apport culturel Maori… lui donna
des ailes. Ses récitations sont magnifiques et instructives. A la différence
de Metoro, qui décrit les signes physiquement ou scande les signifiants ou
parfois les signifiés, Ure vae Iko
récita sur quelques lignes, quelques sections. Il
avait un fort caractère et était
poète, maître des cérémonies. Il y a dans ses récitations des rituels, des généalogies et
un très joli chant de la pluie. De
plus, il n’envoie pas dire ce qu’il pense de la venue de bateaux étrangers ou
de la valeur des tablettes à Tahiti. Sa
mémoire fut réhabilitée en 1936 par les Old Ones[3],
les ateliers des anciens sur la tradition orale, qui commencèrent la page
d’un répertoire de signes rongorongo à la gloire de Ure Vae Iko et de
Tomenika a Tea-Tea, nés Manuscrit A d’Estéban Atan, page sur les signes relevés sur le répertoire Jaussen et les signes
créés durant les ateliers des Old Ones (Courtoisie Maria Atan, fille
d’Esteban). Conclusion 1 : à
la fin du 19e
siècle, trois rapanui, Metoro (1869 1891 devant Tepano
Jaussen), Ure Vae Iko et Kaitae (1886 devant Thomson) ont
témoigné de la manière dont on
travaillait dans les ateliers initiatiques à leur époque : en sémantique
pure. Mais que les paroles des anciens
étaint depuis fort longtemps perdues. Et cela, seul Monseigneur Tepano
Jaussen l’avait compris. Les Rapanui recherchaient les paroles anciennes sur
leur proto-écriture rongorongo avec le vocabulaire qu’il leur restait
consigné dans les lexiques des marins ou des missionnaires… En 1886 les dernières tablettes disparurent. Il en
resta quelques unes enfouies sous la terre ou dans une grotte d’Orongo. Les
signes étaient perdus. Un homme, Tea-tea recommenca avec d’autres signes,
plus proches de la nature. C’est-a-dire que quittant une écriture structurée,
perdue, ils revinrent à la première écriture de l’homme : le symbole.
Tea-Tea fut le père adoptif de Tomenika Vaka Paté. Ne soyons pas surpris si en 1936 Juan Paté
découvrit une tablette dans une maison de Hanga Honu, une tablette en
écriture cursive, se rapprochant des signes de Tomenika que lui avait
enseignés son père adoptif Tea-Tea. Voir les notes de Katherine Routledge sur
www.ile-de-paques.com Page suivante :
Un chant ancestral, le rongorongo tau Rapanui
1914 : Quelques jours avant sa mort, le Maori Tomenika a Tea-Tea récite
un rongorongo tau, à la gloire de
ses ancêtres devant Katherine Routledge.
|